
Nouvelles et évènements
Évaluation du potentiel des coupes partielles dans l’aménagement des forêts boréales
12 août 2025Actualité
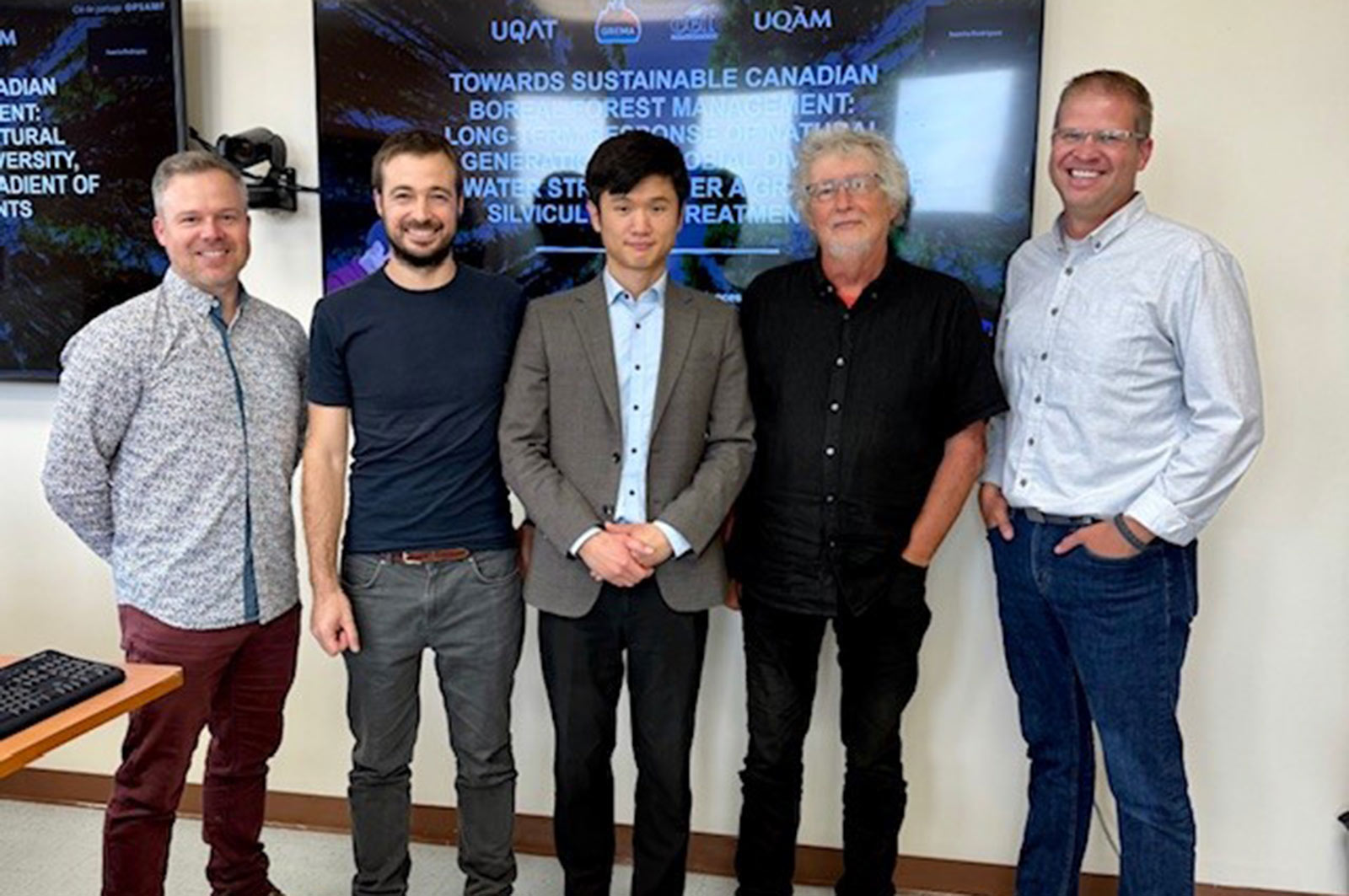
Différents types de coupes forestières sont utilisés dans la forêt boréale canadienne dans une perspective d’aménagement durable, intégrant les dimensions environnementales, sociales et économiques. Dans le cadre de son doctorat en sciences de l’environnement à l’Institut de recherche sur les forêts (IRF), Sanghyun Kim a évalué les effets écologiques à long terme de divers traitements sylvicoles sur la régénération naturelle et la qualité des sols. Il s’est plus particulièrement intéressé aux coupes totales avec protection de la régénération et des sols et aux coupes partielles comme les progressives expérimentales (sélection rapprochée, sélection éloignée, mini-bande). En plus d’étudier la régénération naturelle, il a analysé les impacts sur les communautés microbiennes du sol ainsi que sur le stress hydrique des semis, 18 à 19 ans après coupe, dans des peuplements d’épinette noire de différents âges.
Les résultats montrent que les coupes progressives expérimentales, en particulier celles en mini-bande, ont favorisé une densité plus élevée de semis d’épinette noire. La scarification du sol, l’exposition du sol minéral et l’installation de la mousse Polytrichum ont contribué à créer un environnement propice à la régénération naturelle. Bien que la croissance des semis ait été plus rapide après une coupe totale en raison d’un apport en lumière plus important, leur densité y était plus faible, principalement en raison de la forte compétition exercée par les éricacées, qui colonisent rapidement les sites ouverts non scarifiés.
L’analyse microbienne de la rhizosphère, la zone du sol située à proximité immédiate des racines, n’a révélé aucune différence significative dans la diversité microbienne globale entre les différents traitements, 19 ans après les interventions. Toutefois, les sites de coupes totales présentaient certaines bactéries fixatrices d’azote, telles que Roseiarcus spp., tandis que les sites de coupes progressives montraient une plus grande abondance de champignons ectomycorhiziens, notamment Piloderma spp. Ces résultats suggèrent que les perturbations partielles favorisent des conditions plus propices à l’établissement de symbioses bénéfiques. Par ailleurs, les propriétés physicochimiques du sol sont restées considérablement altérées dans tous les types de coupes. Ces changements persistants montrent que les interventions sylvicoles ont des effets à long terme sur les conditions du sol dans les forêts boréales.
Enfin, Sanghyun Kim a analysé les isotopes stables du carbone (δ¹³C), un indicateur du stress hydrique chez les semis d’épinette noire et de sapin baumier. Les valeurs élevées observées dans les secteurs de coupes totales indiquent un stress hydrique accru, probablement attribuable à l’ouverture complète du couvert forestier. Cependant, les coupes partielles ont maintenu des valeurs similaires à celles des témoins non récoltés, vraisemblablement grâce aux microclimats plus modérés créés par le couvert arborescent résiduel.
Dans l'ensemble, ces travaux démontrent que la récolte partielle peut favoriser une meilleure régénération naturelle, contribuer à maintenir des conditions de sol favorables et atténuer le stress hydrique chez les conifères en régénération.
Sanghyun Kim a soutenu sa thèse intitulée « Vers un aménagement durable de la forêt boréale canadienne : réponse à long terme de la régénération naturelle, de la diversité microbienne et du stress hydrique selon un gradient de traitements sylvicoles » le 4 août dernier, au campus de l’UQAT à Amos. Ses travaux ont été réalisés sous la direction de Miguel Montoro Girona, professeur à l’IRF et sous la codirection d’Yves Bergeron, professeur émérite et de Patricia Raymond du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. À noter que son projet a été mené dans le cadre des activités du Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi, un partenariat entre l’UQAT et la MRC Abitibi lancé en 2021. De plus, les résultats des travaux ont également été publiés dans la revue scientifique Forest Ecology and Management.