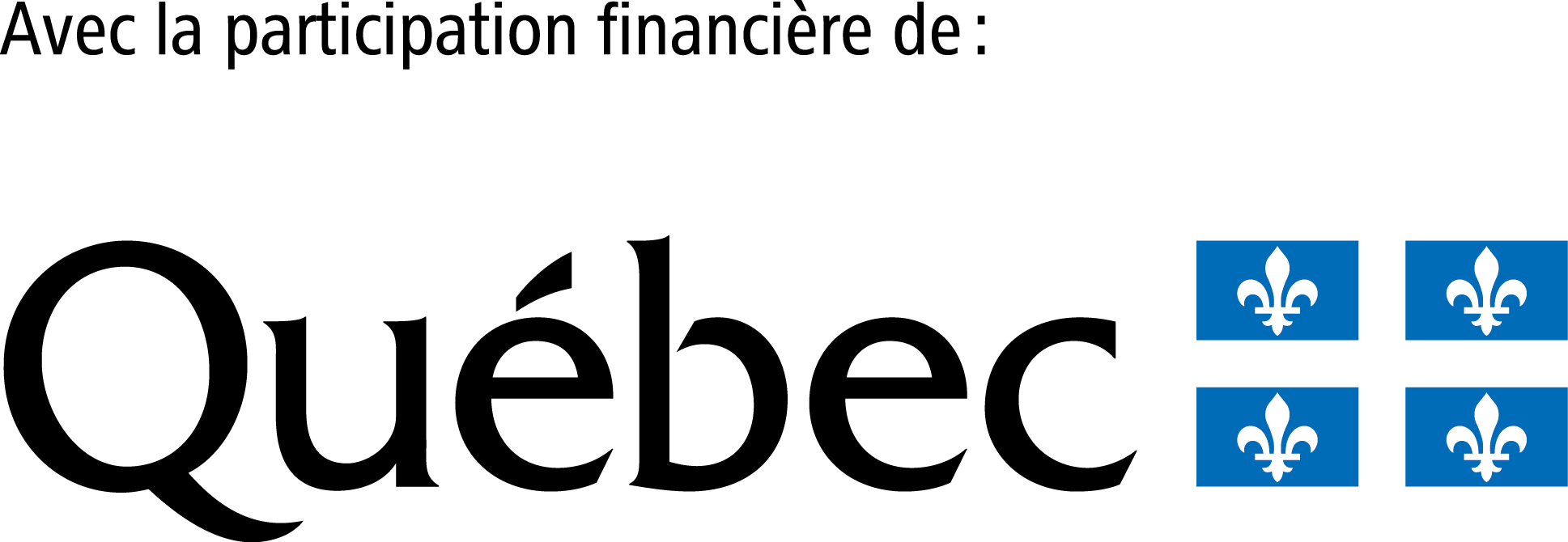Découvrir le projet
Les objectifs spécifiques visés avec le programme Passeurs culturels à l'UQAT sont essentiellement de :
- Stimuler l'intérêt des étudiantes et étudiants en éducation pour la culture et les arts en les incitant à vivre des expériences riches, diverses et inspirantes;
- Rendre les œuvres culturelles et artistiques accessibles aux membres de la communauté étudiante qui se préparent à une carrière en enseignement;
- Favoriser le développement d'un lien personnel et durable avec les pratiques artistiques chez les étudiantes et étudiants afin qu'ils deviennent des ambassadrices et ambassadeurs de la culture dans leur milieu professionnel;
- Outiller les futures personnes enseignantes pour qu'elles puissent sensibiliser à leur tour leurs élèves aux multiples facettes et richesses des arts et de la culture;
- Former un réseau d'actrices et acteurs culturels engagés (personnel enseignant, artistes, travailleuses et des travailleurs culturels, organismes, etc.) dans la médiation et le partage des savoirs culturels, motivés à jouer un rôle clé dans la formation des jeunes générations;
- Mettre en valeur la richesse culturelle et patrimoniale de l'Abitibi-Témiscamingue et de Mont-Laurier en soutenant les créations et initiatives sur le territoire;
- Renforcer la vitalité des lieux culturels régionaux en incitant la population à participer aux activités artistiques et culturelles.
Le programme Passeurs culturels de l'UQAT repose sur l'idée que le contact avec la culture, que ce soit par les arts vivants, les arts visuels ou la littérature, peut enrichir et humaniser les pratiques éducatives. Une formation ancrée dans les réalités culturelles locales favorise l'ouverture à la diversité culturelle et artistique chez les futures enseignantes et futurs enseignants (Lépine et al., 2021).
L'origine du programme Passeurs culturels
Le programme Passeurs culturels à l'UQAT s'inspire d'un projet pilote lancé à l'Université de Sherbrooke entre 2017 et 2020 par Martin Lépine, professeur à la Faculté d'éducation, et son équipe. Le projet, fort du vif succès rencontré tant auprès des étudiantes et des étudiants que de la communauté universitaire et culturelle sherbrookoise, est passé du statut de projet-pilote à celui de programme pleinement intégré aux activités de formation des étudiantes et des étudiants en éducation.
Le rapport d'activité produit à la suite des trois années montre bien les apports et retombées d'un tel programme.
Nous tenons à souligner l'extraordinaire travail du professeur Lépine et de son équipe et les remercions vivement. C'est un privilège pour l'UQAT de pouvoir à son tour affirmer son rôle de pionnière et son engagement dans l'innovation et l'excellence en formation en enseignement en lançant le programme Passeurs culturels de l'UQAT en 2025.
Ainsi, l'UQAT devient la deuxième université du réseau de l'Université du Québec, après l'Université du Québec en Outaouais (UQO), à mettre en œuvre un tel projet destiné aux futures enseignantes et futurs enseignants de la région témiscabitibienne et de la MRC Antoine-Labelle.
Pourquoi héritiers, critiques, interprètes et médiateurs de la culture?
Pourquoi le programme mis en place est-il pensé autour de quatre mots clés : héritiers, critiques, interprètes et médiateurs?
Tout d'abord, il faut comprendre que, parmi les treize compétences professionnelles du référentiel du personnel enseignant, la toute première compétence est « agir en tant que médiatrice et médiateur d'éléments de culture ». Le programme est donc fortement centré sur cette compétence primordiale.
Ensuite, les mots « héritiers » et « critiques » viennent essentiellement de Fernand Dumont, éminent sociologue et philosophe de l'éducation. Dans sa théorie de la culture (1971), Dumont explique que l'idéal éducatif consiste à former des individus à la fois critiques — capables de discernement, de rigueur intellectuelle et de liberté face aux idéologies — et héritiers — conscients des savoirs et des traditions qui façonnent une culture. Être critique, c'est comprendre en profondeur et faire preuve de discernement, alors qu'être héritier, c'est intégrer les fondements d'un patrimoine intellectuel pour mieux le faire évoluer.
Finalement, les mots « interprètes » et « médiateurs » mettent de l'avant la place importante que prend l'interprétation dans la compréhension de notre monde et le rôle central que jouent les enseignantes et les enseignants au sein de notre société. Les enseignantes et les enseignants ou les futures enseignantes et futurs enseignants sont des interprètes de la culture, c'est-à-dire qu'elles et ils ne font pas que transmettre un savoir culturel « brut »; elles et ils ont la responsabilité de comprendre les éléments culturels, d'en dégager le sens, d'accompagner les élèves afin qu'elles et ils les relient à leurs expériences ; les interprètes rendent accessibles et significatifs les éléments de culture. « Interpréter la culture » implique donc une posture active d'analyse, de sensibilité et d'adaptation.
Dans cette vidéo, Denis Simard, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Laval, partage des exemples concrets, issus de différentes situations scolaires, pour illustrer comment la compétence culturelle peut être intégrée en classe.